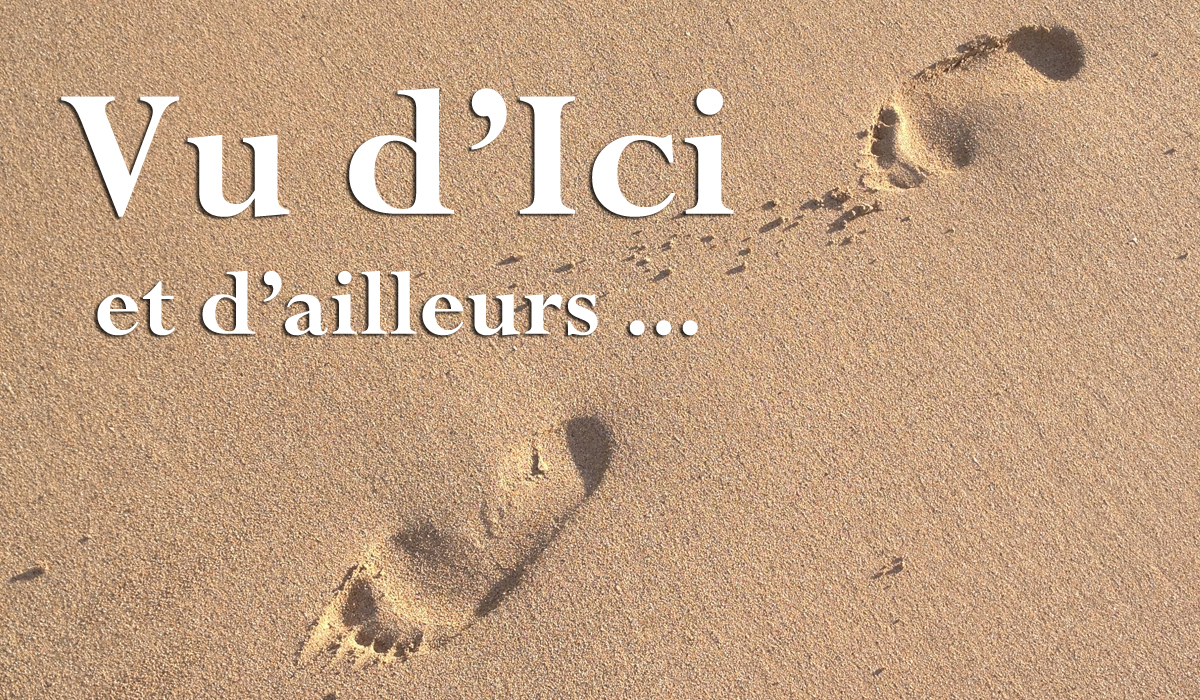SYNOPSIS
LES HOMMES DE GRAND ANSE
A Marie Galante, petite île posée au large de la Guadeloupe, la canne façonne toujours le destin des hommes et le sucre se fabrique encore avec leur sueur et dans le fracas des machines.
Vouant toutes leurs forces à la survie de leur vieille usine sucrière à bout de souffle, les travailleurs de Grand Anse prêtent le temps d’un film leur voix aux paroles oubliées d’esclaves venus témoigner au procès de leur maître en 1842. Voir les portraits
DONNER VOIX, DONNER CORPS
Donnant corps et voix à ces paroles de nègres, ils redonnent vie et sens à cette mémoire qui fait partie d’eux et forge leur présent. Et bientôt, reconnectée à une identité collective, c’est leur propre voix qui s’élève : contre l’effacement et l’oubli, les vivants d’aujourd’hui rompent le silence des nègres.
Tous, planteurs et ouvriers, ils sont au combat, maintenant leur île à flot à la force de leurs bras et tentent d’ignorer les menaces qui pèsent sur leur vaisseau fantôme. La canne était l’instrument de la damnation de leurs ancêtres, elle reste envers et contre tout le symbole de leur dignité.
Le film dresse une vision épique du travail des hommes de Grand Anse pour mieux approcher leur humanité, leur identité.

WORDS OF NEGROES
In Marie Galante, sugar cane still shapes the destiny of men and sugar is still made of their sweat in the clattering of machines. The workers of Grand Anse devote their strength to the survival of their old sugar factory.
The lend their voices to the forgotten words pronounced by slaves at the trial of their master in 1842. He was a slave owner of Marie Galante, accused of the first degree murder of one of his slave : Sebastien, who died after a three months agony in the narrow cell where he had been thrown, after his master accused him of poisoning Cattle.
They are workers and planters and they give back life and meaning to a memory that is part of them and still forges their present. And soon, reconnected to a collective identity, their own voices rise.
They are fighting to keep their island afloat and trying to ignore the threats hanging over « their » factory. The cane was the instrument of the damnation of their ancestors, it remains, against all odds, the symbol of their dignity.
FICHE TECHNIQUE
Durée du film : 80′
Langues de la version originale : français, créole
Format 16/9 – couleur – son stéréo
Réalisatrice : Sylvaine Dampierre
Sur une idée de : Sylvaine Dampierre & Gilda Gonfier
Image : Renaud Personnaz
Son greg Le Maître
Montage : Sophie Reiter
Photographe : Bernard Gomez
Productrice : Sophie Salbot
Production : Athénaïse
Co Production : Varan Caraïbe , Micro Climat , PROARTI
Avec le soutien du CNC / de la Région Guadeloupe / de la Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage / de la Fondation Esclavage et Réconciliation.
PRESS KIT
.
L'USINE DE GRAND ANSE
MÉMOIRE D’USINE
L’habitation sucrière Grand Anse apparaît dès 1665 et compte encore 74 esclaves lorsqu’en 1845 son propriétaire vend une partie de ses terres à la Compagnie des Antilles pour y construire une usine. Après l’abolition de l’esclavage, l’usine sera régulièrement agrandie et équipée jusqu’à devenir la dernière usine sucrière de Marie Galante et une de deux dernières usines centrales de Guadeloupe (l’autre étant située en Grande Terre).
La sucrerie Rhumerie de Marie Galante (SRMG) est aujourd’hui une filiale de la COFEPP, entreprise familiale florissante et puissante dans le domaine des vins et spiritueux, les murs et le foncier appartiennent à la communauté de communes de Marie Galante depuis 2001 et la SICAMA, coopérative des planteurs de l’île en est l’actionnaire minoritaire. Elle emploie à l’année 70 permanents qui sont rejoints par des travailleurs saisonniers durant la période de récolte de la canne et de fabrication du sucre entre mars et juillet, l’effectif monte alors à 160 personnes.
L’usine est vétuste et souffre d’un manque d’investissement chronique. Son avenir, et celui des quelques 1300 petits producteurs de canne de l’île – dont une majorité des ouvriers de l’usine – est suspendu à la marche de son antique chaudière. Celle-ci a subit une panne trés grave au début de la campagne de 2021, qui a du être annulée. Mais les ouvriers se sont mobilisés et ont obtenu que des réparations soient entreprises. La centrale a pu redémarrer en mars 2022 …
MEMORY OF A FACTORY
The Grand Anse sugar dwelling appeared as early as 1665 and still housed 74 slaves when, in 1845, its owner sold part of his land to the Compagnie des Antilles to build a factory. After the abolition of slavery, the factory was regularly enlarged and equipped, until it became the last sugar factory in Marie Galante and one of the last two central factories in Guadeloupe (the other being on Grande Terre).
Today, the Rhumerie de Marie Galante (SRMG) sugar factory is a subsidiary of COFEPP, a flourishing and powerful family business in the wines and spirits sector. The premises and land have belonged to the Marie Galante community of communes since 2001, and SICAMA, the island’s growers’ cooperative, is the minority shareholder. The plant employs 70 permanent staff year-round, who are joined by seasonal workers during the cane harvest and sugar production period between March and July, when the workforce rises to 160.
Despite being heavily subsidized, the plant is dilapidated and suffers from a chronic lack of investment. Its future, and that of the island’s 1,300 or so small-scale sugarcane growers – most of them factory workers – hangs on the operation of its ancient boiler. It suffered a serious breakdown at the start of the 2021 campaign, which had to be cancelled. But the workers rallied round and managed to get repairs carried out. The plant was able to restart in March 2022…
PAROLES D'ESCLAVES
Dans les sources judiciaires
LA GAZETTE DE LA GUADELOUPE ET LES CHRONIQUES JUDICIAIRES
On ne sait avec certitude quand commença la publication de la Gazette de la Guadeloupe, hebdomadaire de 4 à 6 pages imprimé à Basse-Terre dont les archives ne conservent que 2 années de publication (1788/89). Elle fut remplacée quelques années plus tard par la Gazette officielle de la Guadeloupe qui continua de paraître bien au-delà de l’abolition.
Comme la plupart des périodiques publiés aux Antilles, elle a une vocation avant tout utilitaire et un caractère semi-officiel, publiant les avis, circulaires, arrêt du Gouverneur, ordonnances et règlements qui régissent la vie coloniale, avec leurs rubriques récurrentes : Avis de départ, Prix des denrées et marchandises, Avis de Marronnages, Nouvelles Maritimes … ainsi que des Chroniques judiciaires.
C’est ainsi que fut publié entre le 18 janvier et le 2 février 1842 le compte rendu détaillé du procès de Louis Joseph Vallentin, comparaissant devant la Cour d’Assises de Pointe à Pitre pour le meurtre avec préméditation de l’esclave Sébastien. En effet un certain nombre de procès impliquant des maîtres se sont tenus durant les 3 dernières décennies de la période de l’esclavage, souvent à l’initiative de juges métropolitains fraîchement débarqués aux Antilles.
Le retentissement de ces procès, répercuté jusqu’en métropole dans des journaux spécialisés et le récit atrocités commises par les maîtres, ont pu contribuer à la formation d’une opinion abolitionniste. Victor Schœlcher lui-même évoque longuement ces affaires dans son ouvrage « Des Colonies françaises – Abolition immédiate de l’esclavage » paru en 1842.
JUDICIARY CHRONICLES IN THE PRESS
It is not known for certain when the Gazette de la Guadeloupe began publication, a 4-6 page weekly printed in Basse-Terre, of which the archives preserve only 2 years of publication (1788/89). It was replaced a few years later by the Gazette officielle de la Guadeloupe, which continued to appear well after abolition.
Like most periodicals published in the West Indies, it had a primarily utilitarian vocation and a semi-official character, publishing notices, circulars, Governor’s decrees, ordinances and regulations governing colonial life, with their recurring headings: Avis de départ, Prix des denrées et marchandises, Avis de Marronnages, Nouvelles Maritimes… as well as Chroniques judiciaires.
Between January 18 and February 2 1842, for example, a detailed account was published of the trial of Louis Joseph Vallentin, appearing before the Pointe à Pitre Assize Court for the premeditated murder of the slave Sébastien. Indeed, a number of trials involving slave masters were held during the last 3 decades of the slavery period, often at the initiative of metropolitan judges who had just arrived in the West Indies.
The repercussions of these trials, echoed in the metropolis in specialized newspapers, and the accounts of atrocities committed by the masters, may have contributed to the formation of abolitionist opinion. Victor Schœlcher himself refers to these cases at length in his work « Des Colonies françaises – Abolition immédiate de l’esclavage », published in 1842.
PAROLES D’ESCLAVES FRANÇAIS
L’histoire de l’esclavage est une histoire silencieuse dont les acteurs n’ont laissé que peu de traces. Qu’en reste-t-il aujourd’hui ? Des livres de compte et des récits de voyageurs effarés, des plaidoyers vibrants d’abolitionnistes, quelques ruines de moulins, des toponymes qui marquent au fer rouge la géographie des Antilles où chaque section porte le nom d’un ancien propriétaire esclavagiste et une mémoire aux pistes brouillées sur laquelle s’est construite une identité en souffrance …
Il existe quelques récits rédigés le plus souvent à postériori par des esclaves affranchis des colonies britanniques ou des Etats-Unis. Mais pour la France, seules les archives judiciaires gardent la trace de paroles prononcées par des esclaves : les procès-verbaux de leurs réponses aux questions des magistrats formulées lors de l’instruction d’affaires pénales, ou prononcées au sein d’un tribunal.
En effet, le droit esclavagiste qui a dénié toute reconnaissance civile à l’esclave a toujours reconnu sa responsabilité pénale. Prévenu ou accusé d’une infraction, ou comme ici témoin dans une procès impliquant son maître, sa parole est suscitée et inscrite dans la procédure.
Ces traces sont bien sûr à manier avec précaution : paroles contraintes, aliénées à la justice blanche, prononcées à la barre sous le regard menaçant du maître, retranscrites et traduites par le greffier d’un tribunal, elles ne nous sont pas moins une source précieuse.
La lecture de ces documents nous plonge dans la réalité concrète de l’esclavage, derrière ces dizaines de textes que les historiens commencent aujourd’hui seulement à étudier, s’entend l’écho de leurs voix : l’unique trace écrite de paroles d’esclaves français
L’OUVRAGE « Libres et sans fers », auquel a collaboré Gilda Gonfier, propose une exploration de ces sources judiciaires des Antilles et de la Réunion – dont le procès Vallentin – révélatrices des conditions de vie des esclaves.
THE WORDS OF FRENCH SLAVES
The history of slavery is a silent one, with few traces left by those involved. What remains of it today? Account books and tales of dismayed travelers, the vibrant pleas of abolitionists, the ruins of a few mills, toponyms that have left their mark on the geography of the West Indies, where each section bears the name of a former slave-owner, and a blurred memory on which a suffering identity has been built?
There are a few accounts, mostly written after the event by freed slaves in the British colonies or the United States. In France, however, only court records keep track of the words spoken by slaves: the minutes of their answers to magistrates’ questions during the investigation of criminal cases, or spoken in court.
Slave law, which denied slaves any civil recognition, always recognized their criminal responsibility. Accused or accused of an offence, or as a witness in a trial involving his master, his word is elicited and recorded in the proceedings.
Of course, these traces must be handled with care: forced words, alienated from white justice, pronounced on the stand under the threatening gaze of the master, transcribed and translated by a court clerk, they are nonetheless a precious source for us.
Reading these documents plunges us into the concrete reality of slavery, and behind these dozens of texts that historians are only now beginning to study, we hear the echo of their voices: the only written trace of the words of French slaves.