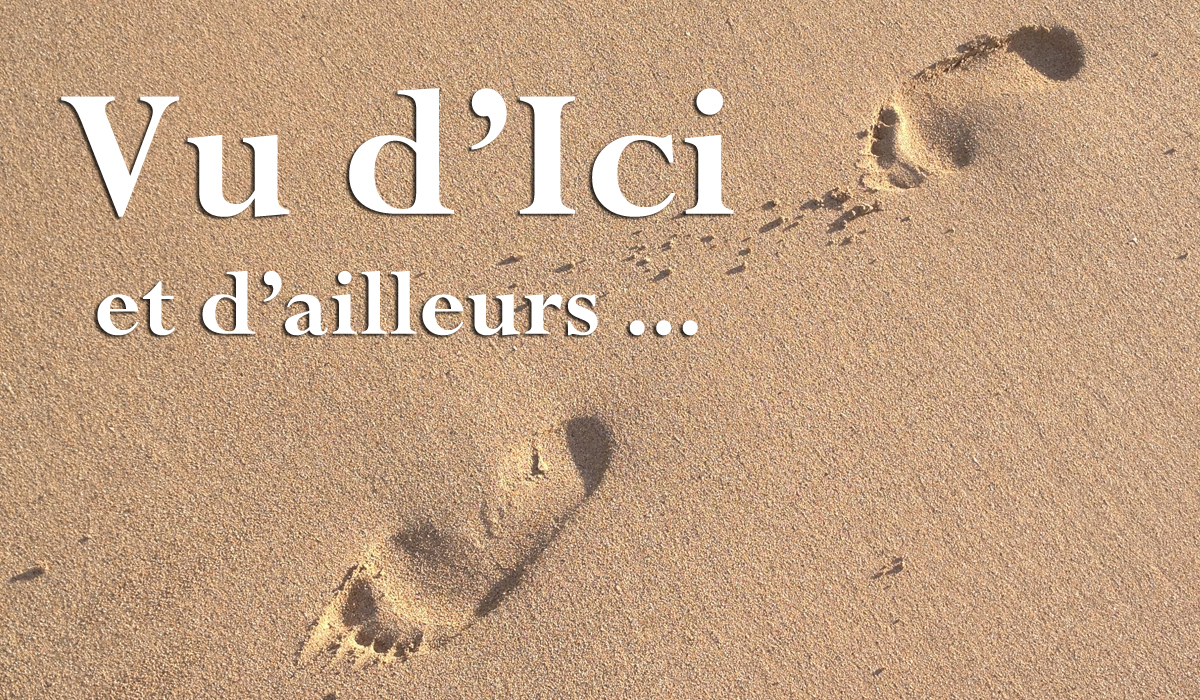Samedi 29 novembre 1999
Quand je sors de chez moi, à 6 heures du matin, une bourrasque d’air tiède s’enroule autour de moi et je pense à l’océan. J’imagine que ce souffle vient de la ville où je me rends ce matin : Rennes. Pourtant dans le hall de la gare T.G.V. c’est un froid pénétrant qui me saisit. Dans ce décors hostile jusqu’au vertige, il semble que le frisson se soit installé à demeure et qu’hiver comme été, les voyageurs doivent y contracter les épaules et remonter leur col.
 Je me réfugie dans une improbable salle d’attente, vaguement chauffée : des rangées de sièges métalliques au design affligeant, béton gris, paroi vitrée ouverte sur un néant visuel. Sur la vaste surface de verre est apposée une unique affiche que je distingue du fond de la salle où je suis assise. Elle est de petite dimension mais je peux lire les mentions en caractère gras; en haut : ENFANTS DISPARUS, en bas : MISSING CHILDREN. Les enfants qui manquent, c’est cette phrase en anglais qui fait le plus échos en moi, c’est cela, presque exactement cela, qui résonnait si fort quand je pénétrais pour la première fois dans la vaste cour de la prison de Rennes : ici les enfants manquent, tous ces enfants qui LEUR manquent.
Je me réfugie dans une improbable salle d’attente, vaguement chauffée : des rangées de sièges métalliques au design affligeant, béton gris, paroi vitrée ouverte sur un néant visuel. Sur la vaste surface de verre est apposée une unique affiche que je distingue du fond de la salle où je suis assise. Elle est de petite dimension mais je peux lire les mentions en caractère gras; en haut : ENFANTS DISPARUS, en bas : MISSING CHILDREN. Les enfants qui manquent, c’est cette phrase en anglais qui fait le plus échos en moi, c’est cela, presque exactement cela, qui résonnait si fort quand je pénétrais pour la première fois dans la vaste cour de la prison de Rennes : ici les enfants manquent, tous ces enfants qui LEUR manquent.
Dans le train, montent des voyageuses élancées dépassant toutes le mètre quatre vingt, elles se retrouvent et babillent joyeusement en anglais ou en russe, certaines sont belles d’autres déjà figées dans une joliesse convenue : j’imagine un exode de tops-models débutantes vers la Bretagne … Cette vision me replonge dans mon rêve de cette nuit. J’ai appris hier soir par un coup de fil in extremis de la directrice que l’entrée dans la prison m’était finalement refusée pour ce samedi. La brutale déconvenue a provoqué ce rêve : j’accédais à une salle d’attente, un sas entre l’extérieur et l’intérieur de la prison qui ressemblait à une salle d’audience de tribunal. Les prisonnières passaient en groupe, guidées par une surveillante, je n’avais pas obtenue l’autorisation de les rencontrer mais je saisissais l’occasion, à leur passage, pour les saluer et m’excuser. Quelqu’un expliquait d’ailleurs pour moi : » ça n’est pas de sa faute, un contretemps, elle s’excuse! » Le groupe des prisonnières était bruissant et bienveillant, poussées par la surveillante elles s’éloignaient en faisant des signes et en lançant des au-revoir joyeux. Je voyais s’éloigner de dos, un groupe de femmes, des jeunes femmes aux chevelures ondoyantes, et une vision presque « Botticelienne » s’imprimait dans ma mémoire : des chevelures mêlées des visages qui se dérobent et des rires cristallins … Fantasme : une attirance ambivalente m’entraîne vers des femmes, ma quête, dans ce film, est celle du féminin…
La voix de Marie-Jo au téléphone m’avait parue jeune j’y avait décelé une pointe d’accent méridional. J’avais imaginé une jeune femme brune…
Au sortir du bus, après un long trajet à travers le centre ville puis les faubourgs, au bas de l’avenue Alexis Carrel jonchées de feuilles d’un jaune incandescent, après avoir tourné devant la très laide église Jeanne d’Arc, j’avais trouvé le patronage, la salle de sport et poussé comme convenue la lourde porte de fer du secrétariat. Là dans le bureau au fond du couloir m’attendait Marie-Jo.
`C’est une femme d’une cinquantaine d’années, à la silhouette lourde qui m’accueillit et je ne pus réprimer un absurde sentiment de dépit. Mais dès que nous prîmes place aux deux extrémités d’une petite table rouge sombre sur laquelle Marie-Jo croisa les bras et commença un récit presqu’ininterrompu de trois heures d’une rare intensité, je plongeais dans un visage.
Sa bouche est petite les yeux noisettes écartés et saillants aux paupières légèrement fardées de vert, ses cheveux bouclés et grisonnants.
La voix est douce teintée d’une pointe d’accent méridional, le ton est mesuré et retenu, l’exposé résolu et méthodique, incroyablement clair, incroyablement net.
« Discipline », c’est d’abord ce mot que répète Marie-Jo pour définir sa vie et expliquer comment elle peut aujourd’hui en surmonter toutes les difficultés matérielles et morales. Discipline et volonté, pour supporter la contrainte, pour survivre à la douleur, pour traverser tout cela. Discipline et contrôle de ce visage et puis soudain, au détour d’une phrase, à la première évocation – peut-être – du jardin, un sourire lumineux l’éclaire. Des rides d’expression s’étoilent autour des yeux et l’on réalise avec surprise que ce visage a été façonné par le sourire: il y a eu du bonheur et de la joie dans cette vie là, avant.
Marie-Jo exécute en « chantier extérieur » les derniers mois de sa peine de sept années. Depuis Octobre, elle n’est plus incarcérée, elle est pourtant toujours prisonnière. Dans le secrétariat de cette petite association sportive elle doit travailler et achever sa formation. Pourtant aucun rapport entre le travail de maquettiste qu’elle avait tant aimé faire dans l’atelier de la prison, et les rares tâches qu’on lui assigne ici, quand l’ordinateur veut bien fonctionner.
Elle dépend toujours de l’administration pénitentiaire, son salaire à l’aune de ceux que l’on touche à l’intérieur, lui laisse une fois toutes les retenues faites, 247 F par semaine. Mais elle doit assurer seule sa subsistance et ses frais médicaux. Marie-Jo est assignée à résidence à Rennes, elle habite un logement « adapté » qu’elle décrit comme sordide et où nous ne pourrons pas nous rendre ensemble. Elle n’a le droit d’y recevoir personne hormis ses ascendants ou descendants, elle doit y être rentrée tous les soirs à 19 heures, pour toute dérogation aux multiples règles qui régissent sa vie elle doit s’en remettre à l’avis de son « référent ». Elle devra lui demander l’autorisation pour que je puisse la filmer Marie-Jo ne sera vraiment libre qu’en avril, alors on lui remettra son pécule et elle reprendra pied dans la « vraie » vie, et ce pas là peut donner le vertige.
Sortie. Sortir , dit-elle, ça n’est pas si facile… Il faut couper les ponts, l’ancienne détenue est interdite de parloir, tout juste lui a-t-on accordé le droit d’écrire à quelques unes de ses anciennes amies, « mais par lettre on ne pas tout dire »… Tant de liens entravent encore la vie de Marie-Jo. La parole coule, j’écoute, et soudain j’entend ceci : « Si je pouvais, j’y retournerais bien, au jardin ».
Transférée de la maison d’arrêt de Bordeaux où elle s’occupait activement des quelques plates bandes, Marie-Jo est arrivée au C.D. de Rennes en 1995. Le jardin était alors à l’abandon et placé sous la coupe de certaines détenues qui s’en déclaraient responsables.
L’arrivée du père Péron au début de 1996 met fin à une période troublée, l’accès du lieu est désormais sous sa responsabilité.
Au printemps dernier, à la demande du père Péron, Marie-Jo reprend les choses en main. Elle va élaguer tailler désherber, diviser, replanter, remodeler les plates bandes.
« Le jardin n’était fleuri qu’au mois d’avril avec les iris et les campanules, les rosiers dépérissaient et ne fleurissaient plus qu’à la cime, on ne pouvait plus cueillir le lilas, le mimosa avait gelé. J’ai taillé les lauriers roses comme une arche et on a placé en dessous un banc de fortune, j’ai dit au père : « tiens, voilà ton nouveau confessionnal! » J’y oubliais la fatigue et le temps, je pouvais passer des heures à démêler les racines des mauvaises herbes. D’ailleurs ça fait ça même à celles qui n’y viennent pas pour travailler mais juste pour prendre l’air, quand à 18 heures il faut quitter les lieux on en entend certaines qui disent « déjà? », c’est le seul lieu dans la prison où l’on peut entendre une chose pareille : on a pu oublier le temps. »
J’interroge Marie-Jo sur cette particularité du lieu, le jardin comme seul lieu où l’on ne se sentirait pas en prison. En effet me dit-elle, d’abord il jouxte presque le mur d’enceinte, le chemin de ronde qui le sépare de ce mur, n’est pas visible et on peut l’ignorer. En fait du jardin on peut voir la façade de la prison, « comme de l’extérieur », on est comme « au bord de la prison ».
Marie-Jo a dépensé des trésors d’énergie dans « son » jardin, et elle m’avoue même avec un de ses sourires de petite fille qu’elle a repoussé sa libération de deux semaines pour trouver le temps de tailler les rosiers avant de partir…
Il fallut bien partir pourtant, et confier son oeuvre à une autre, elle a choisi Marie-Christine. Celle ci purge une peine de trente ans, quatorze années de sûreté lui restent encore à faire, son délit est grave, de ceux qui vous isolent des autres, Marie-Christine n’osait pas se rendre au jardin. Marie-Jo l’a entraînée, lui en a fait découvrir les bienfaits. Elle lui a livrer le jardin comme un talisman, une antidote au désespoir, une voie pour échapper à « l’enfer permanent dans lequel vivent les filles qui ont fait de telles choses ».
Aujourd’hui Marie-Jo est inquiète, que va devenir le jardin, est-ce que Marie-Christine va s’accrocher?
En partant elle lui a aussi confiée sa cellule. « Elle donne sur la ville, on voit une mare où se déversent les eaux de pluie, la grande pelouse toujours déserte et au delà du mur la rue de l’Alma. D’ailleurs certaines filles ne supportent pas et préfèrent la vue sur la cour intérieure. Aux grilles et devant la fenêtre j’avais accrochés plusieurs pots et fait prendre plein de boutures, j’ai confié mes plantes à Marie-Christine. Mais avant j’ai prélevé à nouveau des boutures sur ces plantes, une branche du pommier d’amour, du bégonia et du ficus que j’ai bien enveloppées dans du papier humide et confiées au père Péron, il les a sorties en fraude pour moi, elles ont poussé magnifiquement.
« Bien sûr j’ai la main verte mais ma mère, elle, pouvait faire fleurir des pierres »
Vient alors le moment d’évoquer avec Marie-Jo les autres jardins de sa vie, et notamment le dernier avant la prison, celui où courraient ses deux fils et qui fut perdu, abandonné, vandalisé, vendu.
Marie-Jo sera définitivement libre au mois d’avril prochain, avec un peu de chance elle pourra alors transporter ses plantes dans un deux pièces HLM avec une fenêtre au sud et peut-être un balcon, je serai là sans doute pour la filmer; j’aurai pu aussi j’espère lui donner des nouvelles et même lui montrer des images de « son » jardin, j’aurais pu filmer Marie Christine et visiter sa cellule, j’aurai avancé dans cette histoire et Marie-Jo aura peut être pu commencer à rêver d’autres jardins.
Mais en attendant, il m’apparaît essentiel de recueillir la parole de Marie-Jo au plus vite. La problématique de la sortie est une voie nouvelle pour le film qui s’impose à moi après cette précieuse rencontre. Au milieu du vertige qui saisit Marie-Jo le jardin apparaît comme le seul point d’ancrage, a travers la passion qu’elle met à l’évoquer se révèlent un réseau de sentiments complexes. La force de cet attachement, qui exprime la difficulté à se réapproprier sa vie après une longue incarcération, s’atténuera sans doute, évoluera sûrement. Je souhaite, je l’ai dit suivre Marie-Jo jusque après sa libération définitive, mais cette rencontre marque un véritable point de départ pour le film…