"POUVONS-NOUS VIVRE ICI ?" REPÉRAGES
JOURNAL DE REPÉRAGES – Biélorussie – Avril 2000.
En Biélorussie, j’ai connu un sentiment profond d’exil, j’étais au bout du monde, aussi loin que possible de mon territoire pensais-je. J’ai pourtant découvert très vite que cette terre pouvait devenir aussi la mienne, que j’y avais ma place, ma place c’était le film.
Toute une journée de voyage. Roissy Frankfurt Minsk Stolyn. Traversée d’un pays plat et qui semble infini où l’on oscille du charme à la laideur. Des forêts, des statues des maisons des jardins des charrettes à foin des cigognes, des jeunes femmes des jeunes militaires, des flics taciturnes. Tout semble précaire, vieux, branlant, rafistolé. La nature est comme je l’imaginais. Les meules de foin des fleurs des champs des marais les canaux les tourbières, des bois de bouleaux. Une campagne de légende. Beaucoup de laideur aussi, une pauvreté de fin du monde.
Mon voyage de repérage avait duré 8 jours, 8 jours pour vérifier quelque chose d’essentiel, 8 jours au bout desquels ma vision s’était radicalement transformée : Nous sommes en Biélorussie, dans le district de Stolyn, à quelques kilomètres de la frontière ukrainienne, à 180 kilomètres de la centrale de Tchernobyl, quinze ans après la catastrophe. Le temps ici semble suspendu, les voitures sont rares, des carrioles à chevaux traverse nt la plaine sur des routes mal carrossées.
nt la plaine sur des routes mal carrossées.
C’est la saison des foins, tous les villageois sont dans les prés, des meules fraîches rassemblées autour d’une perche entourent les isbas de bois aux fenêtres sculptées et peintes. Des dizaines de cigognes survolent les troupeaux de vaches et de chevaux et nichent sur les poteaux télégraphiques et les cheminées. Elles sont revenues quelques saisons après l’accident. Le bois fraîchement coupé s’entasse dans les cours. Il vient de la forêt qui enserre le village : les jeunes fûts des arbres ont concentré la radioactivité du sol, on la retrouvera dans les cendres du foyer et du poêle. La population entière est aux champs, dans les forêts pour la récolte de myrtilles, au jardin pour la récolte des concombres et le buttage des pommes de terre. Les hommes et les femmes d’ici, plus que jamais, doivent arracher leur subsistance à la terre : les maisons sont entourées par un grand potager où pas un pouce du sol n’est laissé nu, dans un autre enclos mûrit le blé dont chacun fera son pain
L’été est somptueux, les jeunes gens se baignent dans les marais et les lacs, ils ont le torse bronzé et les jambes blanches des travailleurs des champs. Les vieilles femmes regardent le soir tomber sur leur banc de bois devant la maison. On rentre la vache pour la nuit. Les jeunes filles vont par groupe, les garçons les regardent, et si c’est samedi ce soir, ils iront danser au » club » du village sur de la disco éraillée. La plaine semble infinie et pourtant aucune monotonie ne s’en dégage, l’activité humaine s’y lie partout avec la nature.
Une étrange harmonie se dégage de ce paysage préservé : ici plus qu’ailleurs s’y lit à livre ouvert la vie des hommes, une vie dure et précaire presque autarcique en ces temps de crise économique, dans ce petit pays retranché dans un système en pleine faillite.
Bientôt l’automne allumera des incendies de couleurs dans les forêts, les champignons envahiront les sous-bois – contaminés eux aussi, ils seront pourtant ramassés et vendus. Puis l’hiver recouvrira la plaine. Enfin le printemps arrivera, les églises de bois peintes résonneront des chants de la Pâques Russe, on ira bénir les champs en procession, et le 26 avril 2001 on célèbrera dans tous ces villages le quinzième anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl.
Pouvons-nous vivre ici ? Ils sont sept millions à pouvoir légitimement se poser cette question, sept millions de personnes en Europe à quelques centaines de kilomètres de chez nous, à affronter depuis 15 ans cette question sans réponse.
J’ai donc entrepris de raconter cette histoire, elle est l’occasion d’approfondir radicalement un des aspects de mon travail : la relation de l’homme à la terre, explorée ici dans ses dimensions les plus quotidiennes et les plus universelles : -Peut-on réhabiliter la vie et redonner une place à l’espoir sur ce territoire, ce terroir ?
– Quelle place reconquérir pour l’humain sur la Terre, après l’Accident ?
J’ai été saisie à la vision de ce paysage, en rencontrant les gens de là-bas, d’une émotion radicale : étrangère à cette terre mais concernée par le malheur qui les frappe et même reliée à eux par les retombées même de cette catastrophe continentale. C’est ce sentiment prégnant d’appartenance, que je veux restituer dans ce film. Un film dans ce bout du monde rendu si proche par une apocalypse moderne qui a fait de nous tous des enfants de Tchernobyl.
LETTRE À MA MONTEUSE
« Pouvons-nous vivre ici? » fut un film difficile : la fréquentation régulière des territoires contaminés (4 séjours entre juillet 1999 et Avril 2000), l’âpreté du terrain (une dictature communiste exsangue et ubuesque), la difficulté du sujet, la complexité de la situation furent compensés par la beauté déchirante du pays et les rencontres lumineuses avec ses habitants. Mais les difficultés se corsèrent lors du montage, et les longs mois de rapports tumultueux avec la chaîne Arte et Thierry Garrel, dans un climat de défiance et de paranoïa alimentée par ce sujet hautement sensible … En fouillant dans mes archives, je retrouve ce mail drôlatique adressé à ma monteuse, Sophie Reiter, en janvier 2001. Dur métier que celui de réalisateur !
(…) Sérieux, c’est quoi un point de vue?
Qu’est ce que je cherche avec ce putain de film, je cherche à m’y retrouver, à m’y reconnaître, à éprouver l’altérité. Je vais au plus loin pour essayer de reconnaître, de sentir ce qui m’appartient, ce qui nous appartient à tous dans cette histoire. Le plus petit dénominateur commun : la douleur.
C’est comme pour « un enclos », je cherche un endroit possible où me tenir, même pas longtemps, le temps d’avoir accès à ce qu’on peut partager, ce qu’on peut ramener. Je ne sais pas si c’est bien clair : les films c’est pour se faire violence, pour sortir de soi, pour être dérangée, pour se perdre. On plonge en apnée avec un corde attachée dans le dos et on tâtonne jusqu’à trouver la poignée du coffre, on donne un coup de pied au fond et on remonte, on ouvre le coffre au montage, et on étale ses petits trésors devant les yeux de quelques uns… Qu’est ce qu’on va chercher là, on sait pas, on verra bien, si on le savait on ne plongerait pas… Alors le point de vue, comme ils disent, c’est peut-être la corde, celle qu’on a dans le dos…
Voilà, je plonge sans corde dans l’eau froide, je vais donc remonter à la force des talons, et je n’ai pas intérêt à lâcher la poignée en route (celle du coffre) parce que sinon j’aurai l’air con, toute mouillée sur le bord et les mains vides. heureusement je sais que je pourrai compter sur toi pour me tendre une serviette bien chaude ; mais quand même je sais que tu préférerais que la boîte soit bien pleine…
C’est con, mais de me (te) raconter ces conneries, ça va déjà un peu mieux…
Je t’embrasse
Sylvaine
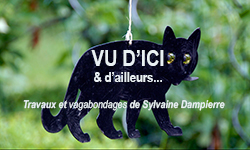
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.